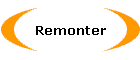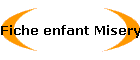La sortie
Cette sortie visait à mieux comprendre le milieu marais en préparation à la découverte du marais de Grande Brière en Loire Atlantique. Elle a été préparée en association avec le service zones naturelles sensibles du conseil général dans le cadre des activités scientifiques parrainées. L'objectif est d'ouvrir ces espaces au public scolaire.
Coordonnées : 0164919704, censga91@CG91.fr
![]()
Sur une bonne demi-journée. Départ à 11h de l’école, arrivée à 11h30. Pique-nique de 11h30 à 12h15.
Début de l’activité à 12h 30. Trois groupes de 8 enfants et 1 adulte accompagnateur par groupe, trois lieux d’ateliers, trois types d’activité.
Rotation des activités. Départ du car à 16h. Arrivée école à 16h30. Adultes accompagnateurs : 3 gardes animateurs, 1 instituteur et 1 parent.
La classe est divisée en 2 groupes, subdivisés en 2 sous groupes.
Les trois zones d’activités sont :
| la zone d’arrivée, | |
| l’observatoire à oiseau et le mirador | |
| la maison forestière ( en bordure d’Essonne ) |
Planning :
|
Zone d’arrivée |
Observatoire |
Maison forestière |
|
|
12h30 / 13 h30 |
Groupe 1 + groupe 2 |
||
|
13h 30 / 14h 30 |
Groupe 2 |
Groupe 1 |
|
|
14h 30 / 15h 30 |
Groupe 1 |
Groupe 2 |
Un animateur prélève un échantillon de sol au niveau du champ ( point de départ ) pour l’ensemble des 3 groupes.
|
Zone d’arrivée : Bord du plateau et vue sur ensemble du marais. 3 points d’activités : parking, plate forme à vaches et entrée dans le bois.
Savoir lire et exploiter une carte pour identifier et caractériser les grands éléments du paysage ( plateau et marais ), dégager l’évolution du paysage ( strates sol et végétation ), comprendre la nature d’un sol par observation et prise d’échantillons pour analyse ultérieure.
Objectif : savoir lire une carte ( orientation et grands éléments du paysage ) Activité 1 : l’orienter en reconnaissant quelques éléments du paysage ( axes routes, vallée ) Synthèse : pour orienter une carte, on se sert de grands éléments du paysage comme la forêt, les champs puis, pour une orientation précise, on utilise des éléments plus petits pouvant indiquer une direction comme routes, fermes, bordure de champs. Objectif : comprendre la nature d’un sol par observation. Activité 2 : prise d’un échantillon de sol et début d’observation ( sol vivant : aéré, aggloméré, hétérogène, garde une légère humidité ). Synthèse : le sol est meuble et semble humide, on trouve des restes végétaux et même des insectes dans cette terre. La vie et donc les plantes pourront s’y développer, c’est une terre de culture.
Objectif : caractériser le milieu plateau Activité 3 : Caractériser le milieu plateau : culture, ferme, peu de variété de culture, maraîchage en bordure humide et moins accessible Synthèse : le plateau, lorsqu’il est plat est constitué de champs avec des cultures intensives et peu variées et comporte également quelques petits bois. Sur les bords moins accessibles pour les engins agricoles, on pratique un peu de maraîchage. Il reste quelques fermes.
Objectif : situer les grands éléments du paysage. Activité 4 : les distinguer et les matérialiser sur une carte au 25/1000ième par coloriage : route, champs, maraîchage, marais, rivière. Cette activité a déjà été menée en classe, la reproduire vise à constater de visu les différentes zones du marais tout au long de la sortie. Prise d’indices pour tracer son itinéraire et aller au point suivant. Objectif : dégager l’évolution du paysage ( strates sol et végétation ), Activité 5 : représenter des différentes strates végétatives : monocultures, maraîchage, pré, bois, étang, rivière sur un schéma du profil du terrain. Conclusion sur les liens entre altitude ( pente ) et végétation. Synthèse : sur le plateau, on trouve un paysage de culture ( champs et ferme ). Quand on descend on trouve des maraîchages puis des prairies, bois et étangs en alternance. Au point le plus bas se trouve la rivière.
A2 Plate forme à vaches
Objectif : identifier et caractériser les grands éléments du paysage. Activité 6 : caractériser le milieu marais : reconnaissance de quelques uns de ses éléments ( bois, prairie, eau ), son relief et son hydrographie ( plat, peu de courant, imprégnation sol). Prolongement de l’activité 4 avec un point d’observation différent. Synthèse : un marais est une étendue plate très humide avec des zones de végétation et des zones d’étangs peu profonds. Objectif : percevoir des différences d’adaptation des êtres vivants à leur milieu Activité 8 : observation des vaches et comparaison avec des " normandes ", différences constatées, hypothèses sur les caractéristiques de l’animal et sa provenance. Synthèse : il n’y a pas d’animaux domestiques dans le marais car seuls les animaux sauvages peuvent résister aux conditions de vie des marais ( humidité, insectes ). Un animal sauvage n’est pas forcément féroce et son utilité n’est pas de satisfaire un besoin direct de nourriture pour l’homme ( viande ou lait ). Par contre, il peut participer à l’équilibre du milieu ( maintient de la prairie en état ). Les animaux peuvent paraître moins grands ou gros mais plus robustes. La présence des longs poils sur la peau et le fait que la neige ne font pas sur eux peuvent indiquer qu’ils proviennent d’un pays plus froid que le nôtre ( Ecosse ). Information sur la peupleraie : présente récemment parce qu’adaptée au sol humide et de bon rendement bois. A été supprimée pour favoriser la végétation au sol bénéficiant ainsi des meilleures conditions ( eau plus soleil ). A3 dans les bois, au cours du déplacement vers le bord d’Essonne
Objectifs :
Activité 9 : reconnaître avec le guide et une clef de détermination des feuillus quelques espèces locales ( arbres marqués le long du chemin ). Observation de la forêt et écoute des explications mettant en valeur les différentes fonctions des bois.
Activité 10 : reconnaître lichen, mousses, champignons, lierre. Possibilité de détacher un peu de lierre pour montrer que l’accroche de ce dernier au tronc est très superficielle. Synthèse : lichen, mousses lierre pousse volontiers sur les arbres mais également sur des supports sans vie ( rochers, murs ). L’arbre ne leur sert que de support. Les champignons préfèrent les troncs d’arbres morts car ils se nourrissent de la substance de l’arbre qui est plus facile à " manger " quand le bois est en décomposition. L’arbre constitue également un milieu favorable pour oiseaux et insectes.
Activité 11 : identification d’arbre avec clef de détermination ( pour les plus mordus ! ). Cette prolongation peut être reportée à un autre moment avec prise d’échantillon et analyse " tranquille ".
Information : les bois sont cultivés pour leur utilité une fois débités ( maison, industrie ) mais aussi pour leur valeur décorative ( allée, jardin ). Ils peuvent également être conservés car ils constituent un " réservoir " de vie participant à l’équilibre et à la diversité végétale et animale. Objectif : identifier et caractériser les grands éléments du paysage Suite de l’activité 7 : zonage du marais, constatation ou vérification tout au long du parcours des différents éléments du marais ( poursuite des activités 4 et 6, complément de coloriage carte si besoin )
A4 souille à sanglier ( optionnel, activité tampon si nécessaire ). Observation de la souille à sanglier. Explication de ce comportement animal.
Zone de l’observatoire et du mirador. Marais et oiseaux
Mettre en valeur la diversité et l'unité du monde vivant
Découvrir plusieurs critères de classification : morphologie, repérage d'un ou plusieurs critères de classement. Approche écologique : rôle et place des êtres vivants, notions de chaînes alimentaires.
Activités dédoublées en 2 sous groupe : aux points A5 et A6. A5 : allée menant à l’observatoire Mise en condition d’observation ( visuelle et sonore ), observation Objectif : reconnaître quelques adaptations du vivant à son environnement. Activité 12 : à l’aide d’un puzzle, lier nourriture et forme de bec chez quelques oiseaux. ( passerelle observatoire prairie ) Objectif : savoir utiliser des jumelles Activité 13 : réglage de l’écartement des 2 lunettes pour obtenir une seule image et faire la mise au point à partir de la molette centrale en observant des pancartes écrites à des différentes distances. ( dans l’observatoire ). Objectif : connaître le nom des parties de l’oiseau qui permettront de l’identifier. Activité 14 à l’aide du schéma décrivant les parties de l’oiseau, les reconnaître et les apprendre. ( embranchement de l’observatoire de la réserve ). Activité annulée ou reportée : Reconnaissance d’un milieu riche ( sol, humidité ), foisonnement de la vie végétale : Quantitatif : comptage nombre de tiges sur une surface limitée donnée
A6 : Observatoire : Objectif :
Objectif : apprendre à être observateur de la nature ( discrétion et mise des sens en alerte ) Activité 15 : confection d’une carte sonore. ( sur marche de l’observatoire de la réserve ).
Activité 16 : observation des oiseaux Synthèse : amener l’enfant à tirer quelques conclusions : cet oiseau se repère essentiellement par ……, il se déplace plutôt sur l ‘eau ou de façon mixte, il se nourrit à tel endroit, son activité essentielle est la recherche de nourriture. Questions non résolues sur place et qui feront l’objet de recherche.
Activité 17 : classification : Peut-on les regrouper ? comment ? exemples ? Synthèse : la classification des oiseaux peut se faire de multiples manières et a varié au cours du temps.
Activité 18 : le marais est-il souvent riche en oiseau ? pourquoi ? Synthèse : le marais, par sa richesse et sa diversité végétale constitue un milieu très propice à l’alimentation et à l’abri pour les oiseaux. A7 : Activité tampon, multiplication des lieux d’observation : parcours le long du chemin principal.
Activité annulée ou reportée : production poétique : prise d’éléments permettant la création d’un texte poétique mettant en scène des éléments naturels
Zone est : Le long de l’Essonne et au niveau de l’ancien abri.
Activité dédoublée : un sous groupe démarrant près de l’ancienne maison, le deuxième au niveau de la maison avec rotation des activité : sol, maison, rivière, allée buis. A8 : Près de l’ancienne maison :
Objectif : à partir d’observations et d’expériences, décrire les caractéristiques des sols rencontrés. Activité 19 : analyse des sols par comparaison des échantillons ( plateau, marais ): Observation et analyses : Couleur : du brun jaune au noir Poids : pesée des différents échantillons à volume constant Présence d’humidité : trace laissée sur papier buvard Présence d’air : volume d’eau pouvant être absorbé par les échantillons. Traces de corps étrangers par observation à la loupe.
Synthèse : le sol des bois des marais est recouvert d’humus. Il est plus riche en éléments végétaux ( morceaux de tige et de racine, insectes ). Il est plus léger car il contient plus d’air. Il absorbe et retient plus l’humidité, contient plus d’éléments en solution. Il est donc le plus propice à la vie et la végétation en résultant est dense et diverse. Objectif : interpréter l’élément habitat pour mieux comprendre le milieu. Activité 20 :
Synthèse : le milieu marais est plutôt inhospitalier. Il n’y a pas beaucoup de maisons et celle présente a une centaine d’année et a été abandonnée il y a une quarantaine d’année. Les matériaux de construction sont souvent locaux ( bois ) avec un support ciment pour éviter le pourrissement de l’habitation dû à la trop grande humidité. La seule fonction de cette maison à cette époque était la protection des lieux car il fallait être sur place. Aujourd’hui, le marais est de nouveau exploité mais pour des raisons différentes, il constitue un milieu extrêmement vivant grâce à la richesse de son sol et à l’eau présente. La vie représente des formes très variées que l’on ne retrouve pas ailleurs et que l’on veut sauvegarder. La maison pourra donc être transformée en habitat pour les oiseaux, petit musée ? la pêche autrefois très présente est maintenant interdite et les cabanons de pêche ont maintenant disparu.
A9 : Dans l’allée bordée de buis.
Objectif : distinguer , dans le paysage, la part de la nature et la part des hommes (modification et aménagement ). Activités : observation de l’allée, explications mettant en valeur les différentes fonctions des forêts et leur évolution historique.
A10 : Au bord de l’Essonne :
L’Essonne : à partir de l’observation de la rivière, déduire le relief et la nature du sol du plateau environnant.
Activité 21
Synthèse : la rivière ayant un écoulement lent et son eau étant très troublée, on peut conclure que le sol du plateau en amont est plat et contient une terre riche ( ni roche, ni sable ).
Activité 22. Le marais est-il naturel ou a-t-il été produit par l’homme ? Observation de la carte, explication des zones géométriques régulières sur l’étang de Fontenay. Explication sur la formation et de l’utilité de la tourbe par l’animateur. Information : la tourbe résulte de la décomposition de terrain végétaux humide qui au cours de millions d’année donne une substance noire : la tourbe que l’on retrouve dans le sous sol à quelques mètres de profondeur. Celle-ci donne un matériau combustible de moins bonne qualité que le charbon ou le pétrole qui proviennent d’une transformation plus longue et plus complète de ces résidus végétaux. L’exploitation consistait en tranchées facilitant l’extraction de pavés de tourbe qui étaient évacués sur des barques empruntant des petits canaux. |
Matériel nécessaire :
|
Ecole |
Zones naturelles sensibles / Conseil général |
|
cartes au 1/25000ième (3) carte du profil du terrain planchette de travail ( support feuille ) plan des marais ( 25 ) papier + crayon (25 ), crayons de couleur récipient pour échantillon sol ( 9 ) +3 récipient verseur ( volumique ) 3 filtre et papier buvard balance pour pesées, filtres 9 prévoir une musette de transport 26 pochettes plastiques |
paires de jumelles (13) Image dénommant les parties du corps de l’oiseau. Jeu bec/pattes/nourriture Fiche de description oiseau Fiche de détermination arbres ( Feuilles plastifiées ). Botte de foin Cordon de sécurité mirador Prévoir une musette de transport par animateur. |
Bilan :
Cette fiche animateur présente différentes activités. Chaque groupe n'a fait qu'une partie du "programme" en fonction des intérêts des groupes d'enfants concernés , du temps disponible et d'éléments "nouveaux" comme l'abondance d'insectes, le "réveil" des grenouilles, la présence inattendue vu la période avancée dans la saison, de nombreux oiseaux : héron, canard, foulque. Les recherches formelles de départ se sont rapidement transformées en ateliers plus spontanés sans prise de note.
La synthèse sur l'ensemble du marais se fera donc en classe où les groupes se révèleront très complémentaires.